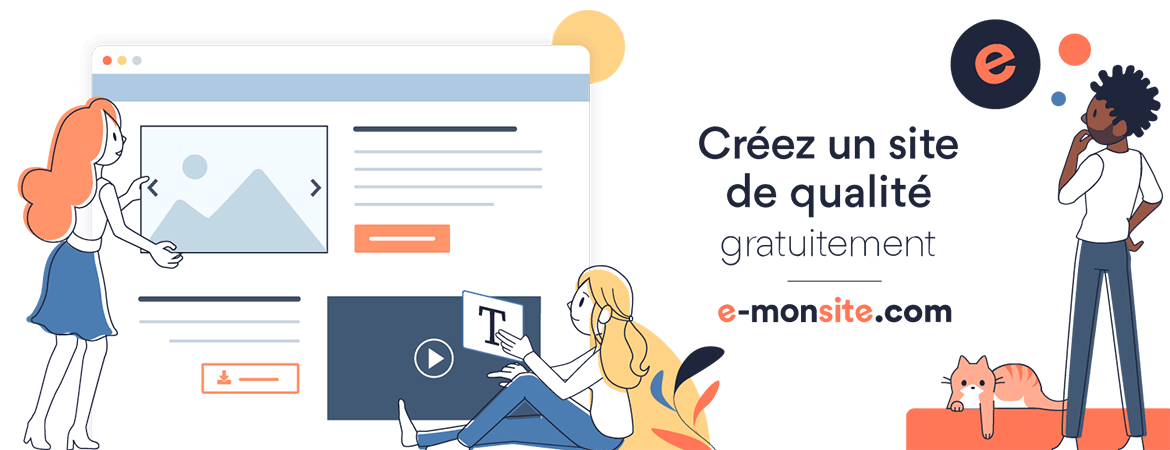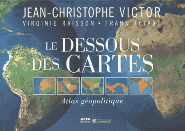Les effets destructeurs du management à la cool
On parle beaucoup d'humaniser les rapports dans l'entreprise. Est-ce une bonne nouvelle ?

Danièle Linhart pourrait comme bien d’autres, sociologues ou journalistes qui font profession de décrire le réel, se retrancher derrière une prudente impartialité. Mais non. Le pouvoir d’écrire et d’être lu a chez elle l’ambition d’être mis au service d’un progrès humain, ce qui rend son livre d’autant plus captivant. A tous, petit fonctionnaire ou cadre, ouvrier ou travailleur intellectuel, elle tend un décodeur pour décrypter le malaise diffus qui se propage en milieu professionnel sans que ceux qui en souffrent se l’expliquent toujours bien. Elle leur offre de comprendre ce que l’on vit, à l’heure du burn out pour tous.
Notre siècle croit dépassée l’image d’un Chaplin à califourchon sur la machine, aux heures féroces du taylorisme ? Bien à tort, nous dit la chercheuse. Elle explique en détail comment le management contemporain peut être vu comme la poursuite du taylorisme par d’autres moyens :
Taylor apparait à bien des aspects comme le précurseur de la posture managériale qui domine la période actuelle: se positionner au nom du bonheur des salariés, prétendre à un système équitable, juste et orienté vers le bien commun, mettre en avant les difficultés d’organisation, et de management du travail, invoquer la science, l’objectivité, la neutralité, ces attitudes ne sont pas sans rappeler bien des allégations et argumentations accompagnant les discours modernes.
A ce stade, un retour vers le passé s’impose pour rappeler qui fut ce Taylor qui divise la postérité. Un bienfaiteur de l’humanité pour certains, car soucieux d’accroitre le bien-être en allégeant la tâche, en la réduisant à un geste unique et simple, à la portée de tous. Un diable pour bien d’autres, coupable d’avoir transformé l’homme en machine et inventé les «cadences infernales», perfectionnées ensuite par Ford et ses chaines de montage.
Frederick W.Taylor (1856-1915) est l’inventeur de ce qu’on a appelé avec grandiloquence «l’organisation scientifique du travail» (OST). Il cherchait une solution pour mettre un terme à l’«irréductible conflictualité» entre les patrons fâchés par la «flânerie systématique des ouvriers» et ces derniers, peu pressés d’en faire plus, compte tenu du ridicule de la paye. Le travail, on le sait, fut décomposé et la tâche de chacun réduite à un automatisme. De cette fracture dans l’histoire ouvrière, on a retenu la parcellisation. Mais la logique taylorienne, explique Danièle Linhart, c’est avant tout la domination, «la prise en main des ouvriers par l’organisation», et l’affaiblissement de leur savoir-faire.
Taylor s’évertue à nier la dimension politique du travail pour n’en retentir que la dimension technologique, économique, ergonomique ou morale afin de créer les conditions d’un consensus, écrit-elle. Il va chercher la science qu’il présente comme neutre et objective.
Mais évidemment, il passe sous silence ce fait que la science sera mise en œuvre par le patron pour servir ses propres objectifs. Car il a décidé de que ce sera au patron de mobiliser cette science, ce qui suppose de déposséder les ouvriers de leur métier. Or il ne faut jamais perdre de vue que détenir un métier permet d’imposer des tarifs et de faire obstacle à la volonté du patron. Ne connaissant pas le métier de ses ouvriers, le patron peine à dicter sa loi (…)
La question est d’importance et reste d’actualité : celui qui connait le travail dispose d’un atout de taille, et l’organisation scientifique est là est là pour donner cet atout au patron.
Taylor voulait associer progrès économique et progrès social. Ce faisant, il aura transformé des ouvriers de métiers, porteur d’un savoir-faire autonome, en «simples» exécutants puis en consommateurs, cette révolution s’accompagnant d’une forte hausse des salaires.
Ancien ouvrier modeleur (à Philadelphie), devenu ingénieur à l’issu d’années de cours du soir, mais ouvrier tout de même, Taylor était bien placé pour étudier ses pairs et leur façon de faire. Dans le cadre de son organisation scientifique, il voulait que fussent pris en compte les besoins et qualités individuelles. «On ne doit pas s’occuper d’un groupe d’hommes mais on doit essayer d’aider chaque ouvrier pour lui permettre d’atteindre son plus haut niveau d’efficacité et de prospérité», disait-il.
Taylor trouvait efficace de stimuler les ambitions personnelles ; lorsque les gens travaillent en équipe, prétendait-il, l’efficacité individuelle de chacun tombe au-dessous du niveau de celle d’un ouvrier moins bon. Sans doute avait-il en tête l’inavouable: le groupe facilite l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de protestation et de défense, lesquelles s’affaiblissent lorsqu’un employé se trouve confronté seul à sa hiérarchie. On voit que loin d’être une calamité récente, l’individualisme, est inclue dans le plan taylorien.
Travail à la chaine ou vie de bureau contemporaine, la logique à l’œuvre est la même: affaiblir ce qui fait la force du salarié et sa ressource essentielle, c’est à dire ce que la sociologue appelle tout au long de son livre la professionnalité. «‘’L’organisation’’ veut des gens qui n’oeuvrent pas en fonction de ce qu’ils estiment juste ou noble, écrit-t-elle, mais en fonction des appétits du capitalisme.»
Comment, dès lors, mettre au pas le salarié français, lequel met du cœur à l’ouvrage, cherche du sens dans ses heures ouvrables et ne renonce pas si facilement aux règles de l’art et de la solidarité ? Comment le soumettre, au Pays de la lutte des classes et du CDI majoritaire, qui plus est quand le Code du travail est d’une si belle étoffe ? «En s’adressant à des ressources humaines plutôt que professionnelles», répond la sociologue. Depuis les années 80, l’idée est là qu’il faut «gérer» affects, émotions, subjectivité.
Plus on insiste sur l’humanité des salariés, et moins on les prend au sérieux comme expert de leur travail, ayant leur mot à dire dans les choix organisationnels et stratégiques de leur entreprise. Ce sont toujours d’hommes et de femmes qu’il s’agit, et non de professionnels qui peuvent avoir un point de vue argumenté sur le changement proposé.
La contradiction est flagrante. Les directions affichent un slogan de velours - l’humain au cœur de l’entreprise - mais la prévalence des burn out signale que quelque chose cloche au royaume des bons sentiments:
Le drame du travail contemporain ne vient pas, paradoxalement, de ce qu’il est déshumanisant mais au contraire du fait qu’il joue sur les aspects les plus profondément humains des individus. Au lieu de s’adresser aux registres professionnels qui permettent d’établir une délimitation entre ce que ces individus engagent au travail et ce qu’ils sont, le management moderne joue sur le registre personnel des salariés.
Fini le temps du bonjour compassé du directeur à son subalterne. Toujours cool, le «n+1» tend patte blanche à son salarié sur le mode l’entreprise-est-à-nous-tous-et-ton-avis-nous-intéresse. En réalité, ce mélange des genres fragilise les gens. Sous son blanc manteau, l’orientation humanisante est dangereuse ; si l’affaire tourne mal, ce n’est plus un professionnel qui sera jugé par ses chefs mais la personne toute entière, livrée à une évaluation critique parfois fatale. Or rappelle la chercheuse, «chaque personne au travail a ses propres intérêts sur lesquels elle doit veiller, intérêts financiers mais aussi de gestion de sa santé, à savoir s’économiser physiquement et psychiquement pour ne pas s’épuiser au travail et pouvoir durer.»
Accélération du temps
Toutes ces observations, Danièle Linhart les a exposées plus d’une fois, parfois à ses risques et périls. Elle se souvient d’un symposium, il y a quelques années, réunissant deux cents responsables du service public et d’entreprises privées dans un pavillon chic, non loin des Champs Elysées. Un thème, ce jour-là: le pacte de confiance. Pacte entre le client et son vendeur, pacte entre le client et son prestataire mais pacte surtout entre le salarié et sa hiérarchie. La chercheuse avait pris place sur la tribune entre deux gradés, succédant à un représentant d’Orange venu disserter sur la nécessité de «réhumaniser le travail». Parler davantage avec le personnel, être plus proche, appeler les gens par leur prénom, ne pas oublier de serrer la main – c’était à l’époque des suicidés en série.
Danièle Lihnart avait protesté contre cette comédie. Sans être hostile, bien sûr, à une certaine chaleur autour de la Nespresso (qui le serait ?), elle est soucieuse de rappeler que c’est sa professionnalité, justement, que le salarié veut voir respecter, laquelle constitue sa force et lui donne sa légitimité. Bien plus que sa dimension d’être humain, qui n’est pas remise en cause. (D’ailleurs, pourquoi le serait-elle ?)
Ce jour-là, des ricanements se sont fait entendre dans l’assistance. Du parterre de DRH se sont élevées des voix pour dire que oui, on assume parfaitement d‘attendre du recruté un maximum d’implication, qu’un employé qui n’est pas prêt à faire allégeance n’a pas sa place dans l’entreprise. Danièle Linhart est apparue comme une sociologue marxisante au discours ringard. Souvenir vertigineux pour elle, ce jour-là prise d’un mal qu’elle s’évertue à décrire: le syndrome du has been. Le sentiment d’être dépassé fait des ravages en entreprise et ce n’est pas non plus fortuit:
Cet argument de l’accélération infinie du temps devient une arme de guerre. Non seulement, il conduit à déstabiliser sans cesse les salariés, à brouiller leurs repères et à défaire leurs ancrages, mais il désamorce toute tentative d’analyse critique.
Le voilà, l’inavoué: le changement perpétuel est utilisé comme une stratégie de prise de contrôle. «Le mal qui nous guette les unes et les autres, et qui suscite une antique terreur comme la lèpre, a pour nom l’archaïsme, il est à l’image de la dévalorisation dont souffrent chroniquement les personnes âgées dans la société, les seniors dans les entreprises, considérés comme des boulets dont il faut se débarrasser au plus vite.»
L’entreprise n’est pas toujours tendre avec le salarié de soixante, voire de cinquante ans, chassé par les plans sociaux - cette triste valse aux adieux. Un salarié de soixante ans qui se sent «vieux con» dans le regard de son patron quadragénaire est attaqué dans son autre ressource fondamentale: l’expérience, laquelle autorise le point de vue, la liberté d’esprit, la critique, possiblement la contestation. Un vieux salarié cassé est une bombe désamorcée.
Et tant pis si le départ des anciens risque de vider l’entreprise d’une partie de sa mémoire. Ou plutôt tant mieux, devrait-on dire, car c’est précisément le but recherché. L’une des ruses modernes du management consiste à produire de l’amnésie. Les temps changent, entend-on comme un refrain, il faut sortir de l’archaïsme. D’où le changement perpétuel et sa kyrielle de recompositions, réformes, refontes, réorganisation des espaces de travail, déménagements, sous prétexte de ne laisser personne «s’enkyster». Ce qui alimente l’amnésie, poursuit Danièle Linhart, c’est que les représentations mentales antérieures disparaissent. Où êtes-vous conflits sociaux et rapports de force ? Où sont-elles, les banderoles portant haut le refus de l’exploitation et la lutte des classes ?
Distiller le doute est devenu la technique moderne d’affaiblissement de la professionnalité. A l’ère du management nappé d’humanisme et de cool, chacun est prié de donner le meilleur de lui-même, dans un cadre professionnel présenté comme bienveillant.
Le cadre, d’ailleurs, est pensé pour : en échange d’une production de chartes éthiques et de codes déontologiques, la direction demande toujours plus de loyauté, flexibilité, mobilité, investissement, engagement, attachement à la marque. Les anciens se cabrent. Les nouveaux arrivés, pour la plupart, jouent le jeu et ferment les yeux sur les misères faites à leurs aînés, jusqu’au jour où le milieu festif se transforme en jungle. Le débutant, devenu parent à son tour, se trouve dans l’impossibilité d’établir la frontière mentale nécessaire entre une vie professionnelle chronophage et sa maison, où il voudrait bien rentrer avant l’heure du bain et des aventures de Motordu, et si possible pas trop exsangue.
On assiste à un paradoxe dérangeant, qui veut qu’au moment où on en demande de plus en plus aux salariés, excellence engagement total et prise de risque, face à un travail de plus en plus complexe, on les plonge artificiellement dans un état de fébrilité, un sentiment de peur et d’impuissance qui tend a paralyser leur activité.
Danièle Linhart décrit fort bien le grand malaise diffus contemporain, qu’elle appelle «précarisation subjective du salarié» :
L’instabilité fait partie du paysage habituel des entreprises modernes qui se veulent adaptées à un monde plus fluctuant et exigeant. Mais derrière cette image d’Epinal se cache une réalité bien plus aride : celle de l’inconfort, voire d’un certain degré de souffrance comme levier pour obliger le salarié à rendre les armes et à se transformer en relais efficace des méthodes et de la qualité de travail voulues par leur direction.
Avec ce livre, on comprend l’importance de bien nommer les choses aussi au travail. Dans les open spaces fleuris d’aujourd’hui, le malaise ne doit rien au hasard. C’est une politique.
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021