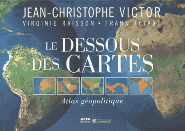Lula, réussite d'un homme du peuple
Le 27 octobre 2002, pour la première fois depuis plus d’un siècle, le Brésil bascule à gauche.
Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, ancien syndicaliste métallo, devient président de la République avec plus de 61% de voix. Ce jour-là, les marchés financiers tremblent, des dizaines de millions de Brésiliens démunis reprennent espoir et le monde entier a les yeux rivés sur ce héros de l’altermondialisme.
« La prospérité économique n’a pas de sens si elle ne crée pas de bien être social » dira Lula devant un parterre de patrons français.
En place, le dirigeant court les sommets économiques, drague les pays pour de nouveaux partenariats. Et ça marche !
Le Brésil renoue avec la croissance et les investissements. La côte de popularité de Lula à l’international explose.
Parallèlement, dans son pays, il instaure une politique de rigueur. Les promesses de justice sociale se font un peu attendre. Pourtant les Brésiliens lui font toujours confiance. Et ils sont encore plus de 60% à le réélire le 29 octobre 2006 à la tête du pays.
La pauvreté régresse mais Lula doit faire face à de nombreux scandales qui ternissent son gouvernement.
Bilan en vidéos de ses 8 années de présidence.
Lula, un destin brésilien
Portrait
Elevé dans la misère, syndicaliste populaire puis fondateur du Parti des travailleurs, Lula a forgé son propre mythe. Retour sur l’ascension d’un caméléon politique qui se retire au sommet de sa popularité.
 «Saudade.» Tout à la fois mélange de mélancolie, de rêverie et de tristesse, le vocable est quasiment intraduisible, mais c’est avec saudade qu’une majorité de Brésiliens se rendra aux urnes, dimanche prochain, pour élire leur prochain président de la République. Pour la première fois depuis le retour au suffrage universel, en 1989 - après vingt ans de dictature militaire -, le nom de Luiz Inácio Lula da Silva ne figurera pas sur les bulletins de vote. Paradoxalement, son absence va encore accroître la cote de l’actuel président qui termine son séjour au palais du Planalto, à Brasília, avec une popularité jamais égalée (plus de 80 %).
«Saudade.» Tout à la fois mélange de mélancolie, de rêverie et de tristesse, le vocable est quasiment intraduisible, mais c’est avec saudade qu’une majorité de Brésiliens se rendra aux urnes, dimanche prochain, pour élire leur prochain président de la République. Pour la première fois depuis le retour au suffrage universel, en 1989 - après vingt ans de dictature militaire -, le nom de Luiz Inácio Lula da Silva ne figurera pas sur les bulletins de vote. Paradoxalement, son absence va encore accroître la cote de l’actuel président qui termine son séjour au palais du Planalto, à Brasília, avec une popularité jamais égalée (plus de 80 %).
Acteur incontournable de la vie politique brésilienne depuis trente-cinq ans, il a réussi à s’identifier si intimement au Brésil des humbles et des déshérités, à faire passer dans les esprits ses réformes économiques et sociales, à peaufiner l’image de grande puissance de son pays, qu’il est devenu la référence de tous les dirigeants d’Amérique latine. En 1978, quand l’ancien syndicaliste défie la dictature militaire en appelant à la grève les métallos de São Paulo, les Brésiliens comprennent très vite qu’un leader est né. Mais qui aurait pu prédire une telle métamorphose ?
L’ancien pourfendeur du capitalisme suscite aujourd’hui la plus grande confiance des patrons ; le catholique «à sa manière» reste le politicien le plus apprécié des catholiques, mais aussi d’une grande partie des évangélistes, de plus en plus nombreux au Brésil et qui conspuaient la gauche avant son accession au pouvoir ; le vampire des marchés avant son élection a su accompagner la puissance financière d’un Brésil dont les capitaux inondent presque tous les pays du monde ; le leader syndical, habitué à haranguer les foules le doigt levé, est devenu le tribun recherché et adulé des grandes scènes internationales. Au point que le magazine américain Time l’a classé en 2010 comme l’un des 100 hommes les plus influents du monde. Mais le candidat de 2002 qui affirmait durant la campagne présidentielle qu’assurer «à tous trois repas et un toit, faire qu’il n’y ait plus un seul enfant dans les rues, ce n’est même plus de la politique, c’est de la morale», n’est pas arrivé au bout de la tâche.
«Lula est la somme de ces contradictions, un concentré d’imperfections en tout point semblables aux nôtres», estimait, en 2006, le sociologue José de Souza Martins dans une tribune publiée par le quotidien O Estado de São Paulo. Dingue de foot dans un pays où le ballon rond est un véritable passeport - il lui arrive d’organiser une partie avec ses ministres autour d’un barbecue -, amateur de cachaça, l’eau-de-vie locale, Lula a dû renoncer au cigarillo (cette fois est la bonne, jure-t-il) après une crise d’hypertension qui l’a contraint, en début d’année, à déclarer forfait pour le très huppé forum économique de Davos (Suisse). Le Président est tout autant capable de s’adresser aux ménagères des bas quartiers de Rio avec une casquette «100 % favelas» vissée sur le crâne, que d’être ovationné à la tribune de l’ONU, d’intervenir fermement dans le cadre du Forum social mondial ou de tenter de régler le différend Etats-Unis-Iran sur le nucléaire. C’est la seule personnalité à être à la fois plébiscitée par les altermondialistes et par leurs adversaires, par Hugo Chávez, comme par Silvio Berlusconi.
Du temps de ses activités syndicales, il déployait déjà un égal talent pour mobiliser les ouvriers et négocier avec les patrons. Il sait, dans toutes ses interventions publiques, jouer de son extraordinaire pragmatisme de syndicaliste, toujours disposé à la médiation et au compromis plutôt qu’à l’affrontement idéologique. De fait, Luiz Inácio Lula da Silva a réussi à se poser en trait d’union entre deux mondes. Véritable caméléon politique, il a par ailleurs cultivé l’énigme Lula, et fait de l’incroyable roman de sa vie une pièce fondamentale de son irrésistible ascension et de sa longévité politique.
1966-1979 : l’ouvrier à l’esprit revendicatif
 Né le 27 octobre 1945 - c’est la date qui figure sur son certificat de baptême alors qu’il serait né, selon ses frères aînés, le 6 octobre - à Garanhuns, sur les terres arides du sertão de l’Etat de Pernambouc (Nordeste), Luiz Inácio da Silva est le septième enfant d’une fratrie de huit. Son père et sa mère sont analphabètes. Fuyant la misère des champs, son père, Aristides Inácio da Silva, abandonne les siens, quitte la région, s’engage comme docker dans le grand port de Santos, à quelque 70 km de São Paulo et… refonde un foyer avec la cousine de sa femme. Un grand classique du machisme local.
Né le 27 octobre 1945 - c’est la date qui figure sur son certificat de baptême alors qu’il serait né, selon ses frères aînés, le 6 octobre - à Garanhuns, sur les terres arides du sertão de l’Etat de Pernambouc (Nordeste), Luiz Inácio da Silva est le septième enfant d’une fratrie de huit. Son père et sa mère sont analphabètes. Fuyant la misère des champs, son père, Aristides Inácio da Silva, abandonne les siens, quitte la région, s’engage comme docker dans le grand port de Santos, à quelque 70 km de São Paulo et… refonde un foyer avec la cousine de sa femme. Un grand classique du machisme local.
Sa mère, Euridice Ferreira dite Dona Lindu, décide à son tour d’immigrer vers le riche Etat de São Paulo pour subvenir aux besoins de sa famille. Un autre classique d’une société matriarcale où les épouses, souvent délaissées, ne se délestent pas de leur rôle de mère. Les Ferreira-da Silva s’installent dans un premier temps à Vicente de Carvalho, une banlieue pauvre de la ville de Guarujá. Le jeune Lula fréquente enfin une école de quartier, l’établissement Marcílio Dias, où il apprend à lire à 7 ans. Il y effectuera une courte scolarité de quatre ans.
En 1956, la famille part s’établir à São Paulo. Luiz s’est improvisé commerçant ambulant, comme des milliers d’enfants de la rue taraudés par la faim. Vendeur d’oranges, de cacahuètes ou de cigarettes à l’unité, il finit par se faire engager dans une teinturerie à 12 ans.A 20 ans, il devient ouvrier métallurgiste dans une grande usine de São Bernardo do Campo, ville industrielle de la banlieue de São Paulo. Aujourd’hui encore, il ne manque pas une occasion de rappeler que son seul titre scolaire est un diplôme de mécanicien-tourneur. A partir de cette époque, le jeune Lula commence à forger son esprit revendicatif face à un patronat borné et soutenu, dès 1964, par l’intransigeante dictature militaire. Son passé d’extrême misère, lieu commun de la majorité du petit peuple brésilien qui ne profite en rien du boom économique du début des années 60, lui a permis de coller à la représentation du Brésil des humbles. Il a l’auriculaire sectionné par une fraiseuse sur son lieu de travail. L’accident le rapproche un peu plus de la masse des ouvriers victimes des piètres conditions de sécurité qui prévalent dans les usines.
A 21 ans, il est mis en contact avec le puissant syndicat des métallos par l’un de ses frères, José Ferreira da Silva, dit «Frei Chico» (frère Chico). L’ouvrier da Silva entre au syndicat dont il assume successivement le secrétariat général puis la présidence en 1975. Son épaisse barbe noire, ses cheveux éternellement en bataille, son regard acéré et vindicatif, son zézaiement assumé et ses discours enflammés contre les nantis le révèlent au grand public. En pleine dictature militaire, à la fin des années 70, il conduit les grandes grèves de métallos qui rassemblent jusqu’à 170 000 travailleurs dans les banlieues industrielles de São Paulo. Mais depuis l’été 1978, au-delà de l’action syndicale, Lula estime qu’il est temps que la classe ouvrière possède son propre parti politique.
1980-2001 : grèves, prison et radicalisation
 En février 1980, il fonde le Partido dos Trabalhadores (Parti des travailleurs, PT) en compagnie d’autres syndicalistes, d’intellectuels et de figures de la gauche catholique. Dans son ombre, sa discrète épouse, Marisa Letícia Rocco, aujourd’hui âgée de 60 ans, organise les protestations des femmes et des familles des syndicalistes emprisonnés. Fille d’Italiens pauvres émigrés au Brésil, l’actuelle première dame a vu défiler dans sa cuisine tout ce que le Brésil compte de militants, députés, sénateurs, syndicalistes ou religieux opposés à la dictature. Comme son mari, elle incarne le Brésil d’en bas : ouvrière dans une usine de chocolat dès l’âge de 13 ans, elle est mariée une première fois à un chauffeur de taxi qui sera tué dans une attaque à main armée. En 1974, elle épouse Lula, lui-même veuf depuis 1971 et père d’une fille. Ils ont trois enfants ensemble et Lula a adopté le fils que Marisa a eu de sa première union.
En février 1980, il fonde le Partido dos Trabalhadores (Parti des travailleurs, PT) en compagnie d’autres syndicalistes, d’intellectuels et de figures de la gauche catholique. Dans son ombre, sa discrète épouse, Marisa Letícia Rocco, aujourd’hui âgée de 60 ans, organise les protestations des femmes et des familles des syndicalistes emprisonnés. Fille d’Italiens pauvres émigrés au Brésil, l’actuelle première dame a vu défiler dans sa cuisine tout ce que le Brésil compte de militants, députés, sénateurs, syndicalistes ou religieux opposés à la dictature. Comme son mari, elle incarne le Brésil d’en bas : ouvrière dans une usine de chocolat dès l’âge de 13 ans, elle est mariée une première fois à un chauffeur de taxi qui sera tué dans une attaque à main armée. En 1974, elle épouse Lula, lui-même veuf depuis 1971 et père d’une fille. Ils ont trois enfants ensemble et Lula a adopté le fils que Marisa a eu de sa première union.
Les grandes grèves, qui éclatent en avril 1980, paralysent la production dans toute l’industrie paulista pendant quarante et un jours. Lula a tout naturellement pris la tête du mouvement. Au menu des revendications : augmentations de salaire, garantie de l’emploi, réduction du temps de travail à 40 heures hebdomadaires et contrôle des chefs par les travailleurs. Son leadership lui vaudra un mois de prison au titre des lois sur la sécurité de l’Etat promulguées par l’armée. Rien n’y fait. Lula se radicalise tandis que le pouvoir militaire du général João Figueiredo se lance dans un lent processus d’ouverture politique.
L’inexorable ascension de Luiz Inácio Lula da Silva vers le palais présidentiel a débuté.En 1982, le PT est implanté sur presque tout le territoire brésilien. C’est l’année que choisit Luiz Inácio pour enregistrer son surnom à l’état civil, comme la loi brésilienne le permet. Trois ans plus tard, après d’immenses manifestations populaires, le général João Figueiredo rend le pouvoir aux civils.
Lula est élu député fédéral en 1986. Candidat du PT à la présidence en 1989, il est coiffé au poteau par Fernando Collor de Mello et son Parti de la reconstruction nationale (droite libérale et populiste). Convaincu de corruption, Collor est contraint de démissionner en 1992. En 1994 et en 1998, le leader du PT essuie deux nouveaux échecs présidentiels face au social-démocrate Fernando Henrique Cardoso. Changement de look, de style, de langage… Pour préparer l’échéance de 2002, le chef du PT se plie aux exigences du marketing électoral - qu’il accusait quelques années plus tôt de «tromper le peuple» - en contractant les services des meilleurs spécialistes en la matière.
2002-2006 : tribun et grand manœuvrier
 Le candidat Lula, qui se présente sous la bannière d’une union de partis, en octobre 2002, s’est refait une virginité dans le milieu des affaires et de la politique traditionnelle. Toute référence au socialisme, mythe fondateur du PT est désormais bannie. Le mot «lutte» est soigneusement écarté du vocabulaire, et les discours enflammés contre le capitalisme, pour la redistribution des terres ou pour un moratoire sur la dette internationale du Brésil laissent la place à une rhétorique plus présentable. «J’ai perdu trois élections parce que le peuple avait peur de moi. Il ne croyait pas en quelqu’un qui était son égal. Maintenant, je gagne parce que le peuple a découvert qu’un égal peut faire pour lui ce qu’un autre ne parvenait pas à faire», souligne-t-il, pour expliquer sa victoire, avec 61,3 % des voix, contre le centriste José Serra. Mais les vieux compagnons de route commencent déjà à douter : «Il est devenu un politique professionnel qui peut jouer différents rôles devant différents publics, prêt à passer des accords avec tout le monde», regrettent certains en prenant leurs distances. Car Lula, parangon de l’éthique, se révèle avant tout comme un grand manœuvrier. Afin d’obtenir la majorité au Congrès, il n’hésite pas à s’allier aux oligarchies et aux partis clientélistes. Pour pouvoir gouverner le Brésil, «Jésus lui-même aurait dû s’allier à Judas», se justifiera-t-il en 2009. Dès 2004, des dizaines d’intellectuels claquent la porte du parti qu’ils ont contribué à fonder.
Le candidat Lula, qui se présente sous la bannière d’une union de partis, en octobre 2002, s’est refait une virginité dans le milieu des affaires et de la politique traditionnelle. Toute référence au socialisme, mythe fondateur du PT est désormais bannie. Le mot «lutte» est soigneusement écarté du vocabulaire, et les discours enflammés contre le capitalisme, pour la redistribution des terres ou pour un moratoire sur la dette internationale du Brésil laissent la place à une rhétorique plus présentable. «J’ai perdu trois élections parce que le peuple avait peur de moi. Il ne croyait pas en quelqu’un qui était son égal. Maintenant, je gagne parce que le peuple a découvert qu’un égal peut faire pour lui ce qu’un autre ne parvenait pas à faire», souligne-t-il, pour expliquer sa victoire, avec 61,3 % des voix, contre le centriste José Serra. Mais les vieux compagnons de route commencent déjà à douter : «Il est devenu un politique professionnel qui peut jouer différents rôles devant différents publics, prêt à passer des accords avec tout le monde», regrettent certains en prenant leurs distances. Car Lula, parangon de l’éthique, se révèle avant tout comme un grand manœuvrier. Afin d’obtenir la majorité au Congrès, il n’hésite pas à s’allier aux oligarchies et aux partis clientélistes. Pour pouvoir gouverner le Brésil, «Jésus lui-même aurait dû s’allier à Judas», se justifiera-t-il en 2009. Dès 2004, des dizaines d’intellectuels claquent la porte du parti qu’ils ont contribué à fonder.
La gauche du PT a simplement feint de croire que le recentrage électoral de Lula n’était qu’un stratagème pour accéder à la présidence, oubliant opportunément qu’il n’avait jamais été un idéologue. En 2006, il porte l’estocade à ses anciens camarades: «Si vous connaissez une personne d’un certain âge encore de gauche, c’est qu’elle a un problème», ironise-t-il. «Génétiquement modifié» par le pouvoir - il a permis les cultures d’OGM sous la pression du lobby agricole -, Lula reste néanmoins un grand leader de masses. Face à la solitude des palais, le contact avec le peuple est sa «bouffée d’oxygène». Devant les «siens», il se transforme en tribun messianique et paternaliste qui arpente l’estrade comme un prédicateur, et distribue des autographes comme une pop-star. «Il ne s’agit pas de gouverner mais de s’occuper de son peuple comme une mère de son fils», déclarait-il encore il y a quelques semaines.
«Jamais avant dans l’histoire de ce pays…» La petite phrase qui scande les discours de Lula comme un éternel bilan positif de l’œuvre accomplie, hérisse ses adversaires. «Lula ne reconnaît rien de bon qui ait été réalisé avant lui», s’indigne le sociologue Demétrio Magnoli qui l’accuse aussi d’avoir acheté les mouvements sociaux à grand renfort de deniers publics. Durant les trois premières années de son mandat, le Président a pourtant libéré le Brésil de la tutelle du Fonds monétaire international (FMI), virtuellement annulé la dette internationale (les réserves en devises couvrant les engagements extérieurs du pays) et mis en place la bourse famille, une aide mensuelle versée aujourd’hui à 12 millions de foyers pauvres.
Ses politiques sociales font rapidement de lui le «père des pauvres», un statut qui lui permet de survivre à l’énorme scandale de pots-de-vin qui ébranle son pouvoir en juin 2005. Le chef d’un parti «allié» révèle ce mois-là que le PT verse de l’argent aux députés de sa coalition pour acheter leur vote. Lula, en chute libre dans les sondages, jure qu’il a été «trahi». Avec l’image de Notre-Dame-de- l’Apparition, la Vierge noire du Brésil, à la boutonnière, et une bonne dose de démagogie, il mobilise la solidarité du povão (le petit peuple) en criant à un «complot des élites» pour le destituer. Dans la foulée, il limoge d’anciens camarades et proches collaborateurs comme José Dirceu, son chef de cabinet accusé d’être à l’origine du système d’achat de voix. Le Président s’en sort sain et sauf. Le PT, lui, est laminé par le scandale.
2006-2010 : un président multiclasse
 En 2006, alors qu’il s’engage dans la campagne pour sa réélection, Lula se modèle un physique de jeune premier. Il entreprend une diète drastique qui lui fait perdre 15 kilos, dissout les rides de son front grâce à des injections de Botox et assagit le cheveu et la barbe. Sa femme, elle, a déjà subi plusieurs liftings. Luiz Inácio Lula da Silva est triomphalement réélu au deuxième tour avec 61 % des voix, face à Geraldo Alckmin (droite).
En 2006, alors qu’il s’engage dans la campagne pour sa réélection, Lula se modèle un physique de jeune premier. Il entreprend une diète drastique qui lui fait perdre 15 kilos, dissout les rides de son front grâce à des injections de Botox et assagit le cheveu et la barbe. Sa femme, elle, a déjà subi plusieurs liftings. Luiz Inácio Lula da Silva est triomphalement réélu au deuxième tour avec 61 % des voix, face à Geraldo Alckmin (droite).
Son second mandat consacre un nouveau pays, un Brésil qui a perdu son complexe d’infériorité et veut avoir son mot à dire dans les affaires du monde. Un Brésil qui a renoué avec la croissance tout en accélérant le recul de la pauvreté et des inégalités. «Jamais les patrons n’ont gagné autant d’argent que sous mon mandat et jamais les pauvres n’ont bénéficié d’un traitement aussi humain et civilisé», déclarait-il récemment, en se présentant comme un président «multiclasse».
Pourtant, beaucoup reste à faire. L’enseignement public et les structures de santé laissent à désirer, la réforme agraire est insatisfaisante et les 21 millions de Brésiliens sortis de la misère en huit années de présidence Lula sont dans une situation encore bien fragile. Le Président a par ailleurs une fâcheuse tendance aux dérapages verbaux. Il a comparé les opposants iraniens qui manifestaient contre la réélection contestée d’Ahmadinejad à de mauvais perdants d’un match de foot ; et les dissidents cubains, à des prisonniers de droit commun ! Mais là encore, qui lui en tient rigueur ? Lula est un mythe.
Le nouveau statut du Brésil n’est pas étranger à son prestige, comme l’a montré la désignation du pays pour organiser le mondial de football en 2014, et celle de Rio pour être la ville hôte des Jeux olympiques de 2016. Ce jour-là, Lula a pleuré en public. Il n’a d’ailleurs jamais craint de le faire dans un Brésil machiste où les hommes n’ont pas de larmes : ni quand il a reçu son «diplôme» de président de la République, en 2002, ni quand il évoque le souvenir de Dona Lindu, cette mère courage à laquelle il voue une véritable adoration. Le président sortant serait un écorché vif qui pleure même, dit-on, devant les séries télévisées qui inondent les écrans.
Lorsqu’il quittera la présidence, le 1er janvier prochain, les Brésiliens le voient mal se retirer dans son appartement de São Bernardo do Campo, la ville qui a servi de tremplin à sa notoriété. Il était annoncé candidat au secrétariat général de l’ONU, on le voit à la présidence de la Banque mondiale… Les spéculations sur son avenir, lui qui sera encore en âge de postuler à la magistrature suprême brésilienne dans quatre ans, vont bon train. Lula les balaie d’un revers de main.

Pour l’heure, il s’évertue à faire élire son ancienne chef de cabinet, Dilma Rousseff, à la présidence. Car le grand absent des urnes est l’omniprésent de la campagne : sur les flancs des autobus, au moindre carrefour des grandes villes ou dans tous les spots télévisés, Lula met son immense popularité dans la balance électorale. Après ? Il se verrait bien endosser son costume préféré, celui d’ambassadeur de la lutte contre la pauvreté, en Amérique latine et en Afrique.
Par GÉRARD THOMAS envoyé spécial, CHANTAL RAYES SAO PAULO, de notre correspondante
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021