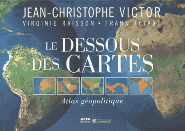Evo Morales en Bolivie, Hugo Chávez au Venezuela, Rafael Correa en Equateur : ces trois dirigeants doivent leur existence politique au fait que la société créole a perpétué jusqu'à aujourd'hui des relations de pouvoir héritées de la conquête espagnole, sans laisser émerger la composante indienne. L'analyse du chroniqueur espagnol Miguel Angel Bastenier.
Evo Morales en Bolivie, Hugo Chávez au Venezuela, Rafael Correa en Equateur : ces trois dirigeants doivent leur existence politique au fait que la société créole a perpétué jusqu'à aujourd'hui des relations de pouvoir héritées de la conquête espagnole, sans laisser émerger la composante indienne. L'analyse du chroniqueur espagnol Miguel Angel Bastenier.De gauche à droite, le président bolivien Evo Morales et ses homologues équatorien Rafael Correa et vénézuélien Hugo Chávez lèvent le poing au sommet de l'Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), 25 juin 2010.
On a qualifié l'Amérique latine d'"autre Occident" ou d'"Extrême-Occident", toujours dans le sens de variante ou de prolongement de l'Europe. Une vision moins charmante consisterait à la présenter comme une caricature du Vieux Continent. Quoi qu'il en soit, toutes ces conceptions eurocentriques du monde indo- ou ibéro-américain sont remises en question en ce XXIe siècle.
On ne peut pas porter le même regard sur toute l'Amérique latine. Même si les Argentins et les Uruguayens auraient tort de se considérer simplement comme des Européens nés dans la Pampa ou sur les rives du río de la Plata, le développement tardif de la colonie et l'afflux massif d'Européens du Sud qui a marqué ces deux pays au XIXe siècle sont tels que la composante européenne reste aujourd'hui très forte. Mais de Salta, dans le nord de l'Argentine, au río Bravo, à la frontière mexicaine avec les Etats-Unis, en passant par l'extrême Sud chilien, l'européanité est un exercice politique qui, pour se nourrir, a dû nier le pays sous-jacent.
La première alerte a été la révolte indienne du Chiapas, en 1994, dirigée par le "créole" Rafael Guillén, plus connu sous le nom de sous-commandant Marcos. Ce mouvement, qui aspirait à ébranler le continent, ne devait cependant atteindre sa majorité qu'en 2006, avec l'élection à la présidence de la Bolivie d'Evo Morales, dont l'objectif est de faire affleurer ce pays d'en bas au détriment de celui d'en haut, le "créolat" [la société créole].
La tentative de cet Indien Aymara pour refonder la Bolivie peut s'entendre comme un premier pas, ou bien comme une fin en soi. Dans la première hypothèse, Morales pourrait penser que la société bolivienne n'était pas encore prête à se défaire totalement de ses habits occidentaux, pas plus que ne l'était en 1810 la société coloniale pour revendiquer l'indépendance au lieu de soutenir le roi d'Espagne Fernando VII contre Napoléon. Dans la seconde hypothèse, la réinvention d'une légalité indienne devrait trouver sa place aux côtés de l'européanité laissée par la colonie. Mais une partie de la population indienne de Bolivie semble redouter que cette première synthèse ne soit en fait la définitive, multipliant par son agitation les problèmes pour l'ancien leader syndical des cultivateurs de coca.
Le président vénézuélien Hugo Chávez, en revanche, appelle "socialisme du XXIe siècle" sa tentative de révolution, noire et métisse, lui accolant le qualificatif de "bolivarienne" pour souligner son ambition de réunification de l'ancien espace impérial. Et cela n'est pas un hasard si Chávez s'est récemment découvert du sang indien.
Le troisième acteur de ce mouvement, bien qu'allié des deux autres, s'en distingue sur des questions de fond. C'est d'ailleurs pourquoi le créolat équatorien, au lieu de livrer une guerre des mots au président Rafael Correa, ferait mieux de prier pour lui : car si son socialisme jacobin et occidentalisant échoue, c'est un Evo équatorien qui les attend ou un Evo à la puissance deux, comme cela pourrait arriver aussi à la Bolivie. On peut en dire autant d'Alan García, rempart de l'Occident au Pérou, et de la plupart des gouvernements d'Amérique centrale.
 Qu'ont en commun ces pays dont les dirigeants bataillent pour changer les relations de pouvoir héritées de la conquête espagnole et perpétuées après l'indépendance ? Appelons cela le logiciel colonial.
Qu'ont en commun ces pays dont les dirigeants bataillent pour changer les relations de pouvoir héritées de la conquête espagnole et perpétuées après l'indépendance ? Appelons cela le logiciel colonial.Ce n'est pas tant que les Espagnols, des assassins génocidaires, comme les qualifie l'auteur de chevet de Hugo Chávez Eduardo Galeano [auteur en 1971 des Veines ouvertes de l'Amérique latine], aient été foncièrement pervers, mais que leurs successeurs, les libérateurs et les artisans de l'indépendance, ont été contaminés par le logiciel colonial, autrement dit incapables de cesser d'être ce qu'ils étaient : des produits de la colonie, qui continue de vivre dans tout ce qu'ils font et qui les a empêchés de laisser émerger le pays d'en bas.
Le premier et grand exemple de logiciel colonial a sans doute été le président mexicain Carlos Salinas de Gortari qui, en signant l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en cette année 1994 d'insurrection, a cru assurer l'entrée automatique de son pays dans le "premier monde" industrialisé.
Le problème de cette Amérique qui veut se réinventer n'est pas son occidentalité plus ou moins profonde, mais le fait qu'elle est marquée par le logiciel d'un monde d'origine, l'Europe, qui a mal atterri en Amérique, qui a été incapable de façonner un pays qui, quoiqu'injuste comme l'est tout l'Occident, aurait au moins su être intégrateur. Morales sait ce qu'il veut, qu'il s'arrête à la première étape ou bien veuille achever la seconde, mais il ne sait pas comment y parvenir. Chávez sait ce qu'il est en train de construire, une démocratie électorale à son service, mais il est probable qu'il ignore où il va. Et Correa entend réformer l'Equateur, mais sans le bouger de sa place en Occident. Une chose est sûre : tous trois doivent leur existence à ce stigmate durable de la colonie, qui transforme en caricature l'imitation latino-américaine du monde occidental.