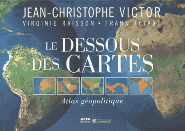Le trou noir du travail au noir
Le travail au noir, symptôme d’un mal français.
 Redécouvert spectaculairement à l’occasion de la crise grecque – dans ce pays, le travail au noir représenterait près de 15 % du Pib – le travail dissimulé n’épargne pas non plus la France. Selon une estimation de l’Insee, le travail au noir – ensemble d activités non déclarées échappant de ce fait à l’impôt ou à la taxation – représenterait 3,3 % de la richesse produite, soit près de 70 milliards d’euros. Un ordre de grandeur qui n’a rien d’anecdotique. Et surtout un phénomène résistant. En dépit d’un arsenal juridique dissuasif renforcé et de mécanismes divers incitant à son “blanchiment” mis en place depuis une dizaine d’années, tout laisse à penser que cette fraude connaît un regain à la faveur de la crise économique. Les remèdes employés sont-ils les bons ? Pour combattre le travail au noir, il faut en comprendre les causes profondes. Et ne pas voir ce phénomène de façon monochrome. La palette de couleurs est large, allant du noir le plus noir – l’activité criminelle, condamnable – au gris le plus pâle des échanges de travaux domestiques. Une telle variété suffirait à elle seule à justifier un traitement tout en nuance. Y sommes-nous prêts ?
Redécouvert spectaculairement à l’occasion de la crise grecque – dans ce pays, le travail au noir représenterait près de 15 % du Pib – le travail dissimulé n’épargne pas non plus la France. Selon une estimation de l’Insee, le travail au noir – ensemble d activités non déclarées échappant de ce fait à l’impôt ou à la taxation – représenterait 3,3 % de la richesse produite, soit près de 70 milliards d’euros. Un ordre de grandeur qui n’a rien d’anecdotique. Et surtout un phénomène résistant. En dépit d’un arsenal juridique dissuasif renforcé et de mécanismes divers incitant à son “blanchiment” mis en place depuis une dizaine d’années, tout laisse à penser que cette fraude connaît un regain à la faveur de la crise économique. Les remèdes employés sont-ils les bons ? Pour combattre le travail au noir, il faut en comprendre les causes profondes. Et ne pas voir ce phénomène de façon monochrome. La palette de couleurs est large, allant du noir le plus noir – l’activité criminelle, condamnable – au gris le plus pâle des échanges de travaux domestiques. Une telle variété suffirait à elle seule à justifier un traitement tout en nuance. Y sommes-nous prêts ?
Insubmersible ! Quelles que soient ses appellations, populaires ou savantes, d’hier ou d’aujourd’hui – le “travail d’à côté”, la perruque, la gratte, les “extras”, les “invisibles” – le travail au noir se renouvelle et fait partie des coulisses de l’économie. Comme un fond de décor nécessaire à la fois au bon fonctionnement des rouages de la machinerie et de la cohésion sociale ? Avec ses 3,3 % officiellement enregistrés par l’Insee, la part du travail au noir ne mériterait-elle pas d’être une bonne fois pour toutes reconnue ? Les vertus du travail au noir - car elles existent ! - sont difficiles à vendre. Cette réticence à lever le frein est bien compréhensible. Fondamentalement immoral et injuste, le travail au noir, même efficace, peut difficilement être encouragé. On ne parle pas ici des activités illégales du type trafic ni du travail des sans-papiers. “Il faut éviter d’adopter le seul point de vue moral pour lutter contre le travail au noir, mieux vaut s’intéresser à ses causes”, explique pourtant l’experte Florence Weber. L’enjeu est crucial pour les politiques publiques. Doivent-elles chercher à le réprimer – la dissuasion est sans doute nécessaire mais personne n’imagine placer un contrôleur derrière chaque Français -, le tolérer en admettant sa fonction de soupape, mais fermer les yeux c’est déjà l’encourager. Ou bien le réintégrer dans la sphère légale en paramétrant un vrai régime dérogatoire. Bref, où placer le curseur entre le répressif qui étouffe et le laxisme qui délite les relations et mine le contrat social ? Poser la question revient à déterminer le degré de tolérance d’un phénomène qui existe de toutes les façons. Refuser d’y répondre, c’est donner raison demain aux libéraux radicaux qui s’étonnent que la majorité des acteurs restent dans le cadre légal en déclarant leurs activités. Une vision par trop cynique qui fait fi de l’héritage des droits et des devoirs qui incombent à tout un chacun.

Un symptôme sur l’état d’une société
Pour François Gardes, professeur d’économie à l’université de Paris, la définition “pure” du travail au noir est une activité qui échappe au paiement de l’impôt et des taxes. “Tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre à évoluer dans l’économie informelle. Tout échange, même non monétarisé – la tonte d’une pelouse contre l’élagage d’un arbre par exemple –, dès lors qu’il mobilise une part de bien public – ici par exemple l’usage de la voierie – devrait être théoriquement assujetti à l’impôt.” Conception extensive qui montre le caractère conventionnel du travail au noir. Aujourd’hui, en France, le travail au noir se définit par infraction à différents codes : fisc, sécurité sociale, travail, résidence (travailleurs sans papiers). Il peut concerner des salariés dissimulés, des heures dissimulées ou des activités dissimulées. C’est la forme la plus répandue. 80 % des procès- verbaux établis relèvent de cette catégorie. La nuance est importante. Pour bon nombre de personnes qui s’y adonnent, ce travail dissimulé n’est pas un délit car l’activité est légale. L’Etat est plus ardent à combattre le travail au noir car il le prive de recettes fiscales et sociales. Un manque à gagner estimé à 2 % du PIB. Ainsi, même à petite échelle, le travail au noir ressemble à un pied de nez quotidiennement lancé à l’autorité. Et au sentiment d’équité. Car ceux qui pratiquent le travail au noir non seulement se mettent en dehors de la légalité, mais en dérogeant au paiement de l’impôt et des taxes, s’octroient un bénéfice indu par rapport aux autres contribuables et cotisants. Il faut donc prendre le travail au noir pour ce qu’il est : un symptôme sur l’état d’une société.
Angle mort, réalité vivace
 Par définition, le travail au noir est une terra incognita. Et un angle mort difficile à visualiser. Difficile mais pas impossible. L’Insee évalue son poids à peu près tous les dix ans, à l’occasion du changement de base. Pour 2000, l’estimation était de 3,3 % du Pib. Depuis, aucune actualisation n’a été opérée, le prochain chiffrage étant prévu pour 2010. Pour les experts de l’Insee, les 4/5e du travail au noir (sous évaluation du chiffre d’affaires, sous déclaration de la TVA) sont le fait d’entreprises ayant pignon sur rue. “Notre méthodologie est sûre. On ne peut pas faire mieux. Notre estimation du travail au noir n’est pas un reliquat, ni le solde de nos comptes”, affirme Fabrice Lenglart, chef du département des comptes à l’Insee. Soit, mais en procédant en partie par extrapolation des redressements fiscaux opérés, les statisticiens ne tombent-ils pas dans le syndrome du réverbère ? Celui qui veut que l’on ne s’intéresse qu’à la partie éclairée du monde. L’activité de contrôle étant elle-même affectée d’un biais – les contrôleurs n’opérant que là où il y a des soupçons de fraude –, personne n’est sûr que le champ couvert par ces investigations prend en compte l’intégralité du phénomène. Une enquête de l’Acoss menée systématiquement dans les hôtels-cafés- restaurants de deux régions tests – l’Ile-de-France et la PACA – avaient révélé des proportions de fraudeurs très élevées, jusqu’à 60 % d’entreprises contrevenantes. Sans compter le fait que, les contrôleurs n’intervenant pas aux premières heures de la journée, ni durant le week-end, cette proportion apparaît comme un minimum ! “Cette étude ne nous a pas conduits à changer notre évaluation”, précise-t-on toutefois à l’Insee. En matière de statistique, difficile d’être plus royaliste que le roi ! Un seul chiffre – troublant – démontre l’écart entre la réalité et les réponses dès lors que l’on quitte les sentiers balisés et que l’on chemine dans le déclaratif : selon une enquête, plus de la moitié des nouveaux-nés (350 000) se garderaient par eux-mêmes. Cherchez l’erreur ! Ou plutôt cherchez la nourrice non déclarée. Selon un autre baromètre – O2/TNS Sofres – 13 % des Français déclarent avoir recours au travail au noir pour leurs services d’aide à la vie quotidienne. Une pratique banalisée donc. Selon Guillaume Richard, le PDG d’O2, société spécialisée dans les tâches ménagères, le travail au noir équivaut au travail déclaré dans le secteur aux alentours de 15 milliards d’euros. “Le recours à une offre légale n’est pas encore totalement ancré dans les comportements”, souligne Maxime Aiach, président d’Acadomia, leader du soutien scolaire à domicile et président de la Fédération nationale du service aux particuliers.
Par définition, le travail au noir est une terra incognita. Et un angle mort difficile à visualiser. Difficile mais pas impossible. L’Insee évalue son poids à peu près tous les dix ans, à l’occasion du changement de base. Pour 2000, l’estimation était de 3,3 % du Pib. Depuis, aucune actualisation n’a été opérée, le prochain chiffrage étant prévu pour 2010. Pour les experts de l’Insee, les 4/5e du travail au noir (sous évaluation du chiffre d’affaires, sous déclaration de la TVA) sont le fait d’entreprises ayant pignon sur rue. “Notre méthodologie est sûre. On ne peut pas faire mieux. Notre estimation du travail au noir n’est pas un reliquat, ni le solde de nos comptes”, affirme Fabrice Lenglart, chef du département des comptes à l’Insee. Soit, mais en procédant en partie par extrapolation des redressements fiscaux opérés, les statisticiens ne tombent-ils pas dans le syndrome du réverbère ? Celui qui veut que l’on ne s’intéresse qu’à la partie éclairée du monde. L’activité de contrôle étant elle-même affectée d’un biais – les contrôleurs n’opérant que là où il y a des soupçons de fraude –, personne n’est sûr que le champ couvert par ces investigations prend en compte l’intégralité du phénomène. Une enquête de l’Acoss menée systématiquement dans les hôtels-cafés- restaurants de deux régions tests – l’Ile-de-France et la PACA – avaient révélé des proportions de fraudeurs très élevées, jusqu’à 60 % d’entreprises contrevenantes. Sans compter le fait que, les contrôleurs n’intervenant pas aux premières heures de la journée, ni durant le week-end, cette proportion apparaît comme un minimum ! “Cette étude ne nous a pas conduits à changer notre évaluation”, précise-t-on toutefois à l’Insee. En matière de statistique, difficile d’être plus royaliste que le roi ! Un seul chiffre – troublant – démontre l’écart entre la réalité et les réponses dès lors que l’on quitte les sentiers balisés et que l’on chemine dans le déclaratif : selon une enquête, plus de la moitié des nouveaux-nés (350 000) se garderaient par eux-mêmes. Cherchez l’erreur ! Ou plutôt cherchez la nourrice non déclarée. Selon un autre baromètre – O2/TNS Sofres – 13 % des Français déclarent avoir recours au travail au noir pour leurs services d’aide à la vie quotidienne. Une pratique banalisée donc. Selon Guillaume Richard, le PDG d’O2, société spécialisée dans les tâches ménagères, le travail au noir équivaut au travail déclaré dans le secteur aux alentours de 15 milliards d’euros. “Le recours à une offre légale n’est pas encore totalement ancré dans les comportements”, souligne Maxime Aiach, président d’Acadomia, leader du soutien scolaire à domicile et président de la Fédération nationale du service aux particuliers.
Les armes d’un combat difficile
Héritée de Vichy – les premières campagnes de lutte contre le travail au noir remontent à l’Occupation – la politique de lutte contre le travail illégal est régulièrement “revisitée” par les pouvoirs publics. Depuis 2007, elle est menée sous l’égide de la délégation à la lutte contre les fraudes, rattachée au ministère du Budget. Elle coordonne les différentes administrations concernées, dont celle de la Direction générale du travail (DRT). “L’arsenal joue sur plusieurs tableaux à la fois : évolution législative, contrôle et sanctions, prévention, sensibilisation et partenariats”, explique Jean Bessière, directeur adjoint à la DRT dont relève le corps des inspecteurs du travail (22 000 postes/équivalents temps plein). En matière de contrôle – la dissuasion – les services sont entrés dans la culture du résultat. Les objectifs assignés ont été fixés précisément : le nombre des procès-verbaux doit progresser de 5 % en rythme annuel, les redressements de 10 % et les procès-verbaux réalisés conjointement par plusieurs administrations devront représenter le quart du total. “Il y a un travail de croisement des informations et des pratiques. Le nombre de procès-verbaux est de l’ordre de 8 000 à 9 000”, précise le haut fonctionnaire. Le rendement de l’arsenal administratif et judiciaire demeure pourtant faible en proportion du phénomène qu’il cherche à combattre. En 2005, le Conseil national des impôts observait que les cotisations recouvrées ne dépassaient pas par exemple 2 % des cotisations éludées – proportion qui va évidemment croissante en fonction des efforts déployés. L’autre volet se veut plus amical. Il s’agit, en jouant sur la fiscalité ou la simplification des démarches administratives, d’inciter le travail au noir à réintégrer les circuits officiels : baisse du taux de TVA à 5,5 % sur les travaux de bâtiment chez les particuliers, exonération d’impôt sur le revenu pour les clients, chèque emploi service. Autant de dispositifs qui rendent sur le papier le travail au noir moins attractif pour le donneur d’ordre. Maxime Aiach ne se lasse pas de faire la démonstration qu’à ce jeu, tout le monde est gagnant dans son domaine d’activité – le soutien scolaire à domicile. Et il aligne ses chiffres. Selon lui, les entreprises “coûtent” à l’Etat 720 millions d’euros (réduction fiscale) et rapportent 958 millions (cotisations sociales et économies d’autres charges). Démonstration probante toutefois en partie contestée par la Cour des comptes. Il n’empêche, près d’une dizaine d’années après la mise en place de ces mesures, tout le monde n’a pas, loin s’en faut, réintégré le travail légal. C’est qu’en dépit des arguments rationnels bien connus qui plaident contre lui - le travail au noir prive les comptes publics de recettes, réduit le potentiel de recrutement des employeurs légaux, fausse la perception du juste prix ou du juste salaire, expose les employeurs et employés à des aléas et des risques très importants (*) – la réalité du travail au noir demeure.
Un puissant révélateur de dysfonctionnements
 Certes, sur l’autre versant, les causes pour expliquer le recours au travail dissimulé sont tout aussi connues, au premier chef celui du coût du travail. “Bon nombre de TPE jouent leur survie en se mettant aux marges de la légalité”, analyse Camal Gallouj, universitaire et expert à Paris I. Et les allègements fiscaux visent précisément à corriger ses coûts excessifs en agissant sur la demande pour la solvabiliser. Selon un sondage de la Commission européenne, les personnes préfèrent recourir au travail non déclaré pour bénéficier d’un prix plus bas (67 %), pour rendre un service à une connaissance (19 %), à aider quelqu’un qui avait besoin d’argent (18 %) Des motivations, on le voit, multiples. La liste des secteurs qui utilisent le plus le travail au noir est instructive. Hôtels-cafés-restaurants ; petits commerces, services aux particuliers, métiers du spectacle, agriculture : autant de secteurs à forte proportion de PME où se pose la question de la rentabilité et des secteurs marqués par une forte irrégularité de l’activité à forte composante de main-d’œuvre. Bref, entre lourdeurs administratives et quête de rentabilité, le travail se déploie en grande largeur. Et l’architecture des droits sociaux fait qu’un employeur pourra facilement trouver un employé prêt à travailler “au black”. Un salaire déclaré peut signifier en effet la perte des minima sociaux, si bien que jusqu’à l’an 2000, le taux marginal d’imposition pouvait avoisiner les 100 % pour les bénéficiaires des minima sociaux, un effet ravageur totalement dissuasif à la reprise d’un emploi, mais en grande partie supprimé par la possibilité de cumuler certaines prestations avec une rémunération d’activité, pointait il y a quelques années un rapport du Conseil national des impôts. En réalité, pour Florence Weber, ethnologue au CNRS (*), “travailler au noir ou faire travailler au noir, c’est manifester de la méfiance envers l’Etat. En trente ans, le travail a profondément changé de sens. Il est passé de l’aménagement d’une “niche de vivabilité” – c’est-à-dire d’une façon pour un salariat stable “d’améliorer l’ordinaire” en recourant à l’économie non officielle – à des activités qui se situent à présent du côté de l’économie de la survie”. Sans doute, la première forme continue-t-elle d’exister dans certaines grandes entreprises publiques ou dans l’administration – une façon d’acheter la paix sociale, un “avantage acquis” défendu par les syndicats et toléré par les directions. Il n’empêche : le modèle socio-économique des années glorieuses – industriel et familial – est en voie d’extinction. Or le nouveau statut du salariat – mobile, autonome – n’est pas encore né. Ce qui crée selon Florence Weber un débranchement des droits sociaux anciens aux réalités de ce salariat nouveau. Sans compter qu’avec la crise, les familles ont non seulement besoin d’activités permettant d’économiser de l’argent mais aussi d’argent courant tout court. Une course au cash propice au développement des petits boulots au noir.
Certes, sur l’autre versant, les causes pour expliquer le recours au travail dissimulé sont tout aussi connues, au premier chef celui du coût du travail. “Bon nombre de TPE jouent leur survie en se mettant aux marges de la légalité”, analyse Camal Gallouj, universitaire et expert à Paris I. Et les allègements fiscaux visent précisément à corriger ses coûts excessifs en agissant sur la demande pour la solvabiliser. Selon un sondage de la Commission européenne, les personnes préfèrent recourir au travail non déclaré pour bénéficier d’un prix plus bas (67 %), pour rendre un service à une connaissance (19 %), à aider quelqu’un qui avait besoin d’argent (18 %) Des motivations, on le voit, multiples. La liste des secteurs qui utilisent le plus le travail au noir est instructive. Hôtels-cafés-restaurants ; petits commerces, services aux particuliers, métiers du spectacle, agriculture : autant de secteurs à forte proportion de PME où se pose la question de la rentabilité et des secteurs marqués par une forte irrégularité de l’activité à forte composante de main-d’œuvre. Bref, entre lourdeurs administratives et quête de rentabilité, le travail se déploie en grande largeur. Et l’architecture des droits sociaux fait qu’un employeur pourra facilement trouver un employé prêt à travailler “au black”. Un salaire déclaré peut signifier en effet la perte des minima sociaux, si bien que jusqu’à l’an 2000, le taux marginal d’imposition pouvait avoisiner les 100 % pour les bénéficiaires des minima sociaux, un effet ravageur totalement dissuasif à la reprise d’un emploi, mais en grande partie supprimé par la possibilité de cumuler certaines prestations avec une rémunération d’activité, pointait il y a quelques années un rapport du Conseil national des impôts. En réalité, pour Florence Weber, ethnologue au CNRS (*), “travailler au noir ou faire travailler au noir, c’est manifester de la méfiance envers l’Etat. En trente ans, le travail a profondément changé de sens. Il est passé de l’aménagement d’une “niche de vivabilité” – c’est-à-dire d’une façon pour un salariat stable “d’améliorer l’ordinaire” en recourant à l’économie non officielle – à des activités qui se situent à présent du côté de l’économie de la survie”. Sans doute, la première forme continue-t-elle d’exister dans certaines grandes entreprises publiques ou dans l’administration – une façon d’acheter la paix sociale, un “avantage acquis” défendu par les syndicats et toléré par les directions. Il n’empêche : le modèle socio-économique des années glorieuses – industriel et familial – est en voie d’extinction. Or le nouveau statut du salariat – mobile, autonome – n’est pas encore né. Ce qui crée selon Florence Weber un débranchement des droits sociaux anciens aux réalités de ce salariat nouveau. Sans compter qu’avec la crise, les familles ont non seulement besoin d’activités permettant d’économiser de l’argent mais aussi d’argent courant tout court. Une course au cash propice au développement des petits boulots au noir.
Tolérer sans encourager ?
Comment sortir alors de ce mal profond ? Une des mesures radicales serait de revoir l’assiette des cotisations sociales qui pèse trop sur le facteur travail en France. Mais le chantier apparaît extraordinairement complexe. Il faudrait aussi favoriser puissamment la sortie de la trappe à pauvreté par des incitations financières. Mais les caisses de l’Etat sont aujourd’hui exsangues. Il faudrait imaginer une redéfinition des droits sociaux et un véritable portage des droits qui tiennent compte de la précarité des postes et des durées de travail. Mais il n’est même pas sûr qu’avec tout cela, il soit possible d’éradiquer le travail au noir. Tant il est vrai que cette forme d’évasion semble enracinée. “Le travail au noir se nourrit du sentiment d’injustice, analyse Camal Gallouj. C’est la tricherie des gens d’en bas qui ont le sentiment qu’il y a des tricheurs bien plus gros au-dessus d’eux. Ne faudrait-il pas reconsidérer le travail au noir avec un regard plus aimable et se résoudre à l’accepter en tant que lubrifiant des relations économiques et sociales ? Et pour donner un peu de respiration à un système trop corseté ?” Conclusion défaitiste ou… d’avenir.
|
Et vous qu'en pensez-vous ? Pour ou contre ? Venez participer au débat, en cliquant sur l'image : |
 |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021