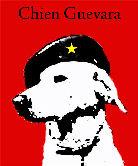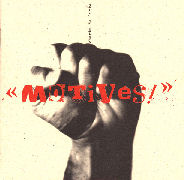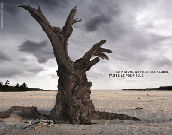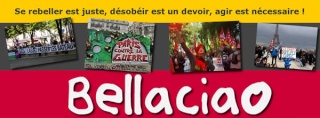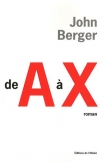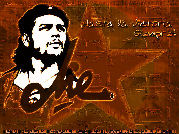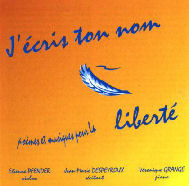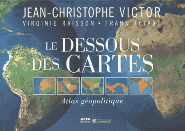Litérature : John Berger
Biographie de John Berger

Peinture, prélude
Né à Londres en 1926, il fait ses études à la St Edward's School d'Oxford. Après avoir servi pendant un an dans l'armée anglaise (1944-1945), il entre à la Central School of Art et à la Chelsea School of Art de Londres. Il ne se voit à l'époque que comme peintre : enseignant le dessin et exposant ses œuvres dans des galeries londoniennes (Wildenstein, Redfern et Leicester).
A partir de 1952, il commence à écrire pour le New Stateman, et s'affirme vite comme un critique d'art reconnu. Partisan d'un humanisme marxiste, passionné par les formalistes et les constructivistes russes, il devient cependant une figure controversé dans le milieu. Il a beaucoup écrit notamment sur Courbet, Cézanne, Picasso, Dürer, Titien...
Un humaniste...
En 1958, John Berger publie son premier roman, A Painter of Our Time (Un peintre de notre temps), qui retrace l'histoire d'un peintre hongrois exilé, dont le journal intime est retrouvé par un critique d'art. Les détails sur le contexte politique et sur le travail artistique de l'histoire sont d'une telle précision qu'ils conduisent plusieurs lecteurs à la considérer comme vraie. Ainsi, un mois seulement après sa publication, des pressions du parti anti-communiste Congress for natural Freedom, contraignent l'éditeur à retirer l'ouvrage de la vente.
Dans les deux romans qui suivent A Painter of our time, The Foot of Clive and Corker's Freedom, John Berger s'attache à décrire une vie quotidienne soumise à l'aliénation et à la mélancolie. L'écrivain supporte en effet de moins en moins bien les conditions de vie britannique. En 1962, il choit de s'exiler en France.
... en lutte
George Steiner, qui fait partie du jury, écrira un an plus tard dans le New Yorker : « Non seulement le livre est difficile, déconcertant, mais l'auteur lui-même est du genre réfractaire insaisissable. »
John Berger est l'auteur de plusieurs autres ouvrages à teneur sociologique, comme Un Métier Ideal. Histoire d'un Médecin de campagne (A Fortunate Man, 1967), un livre documentaire illustré par les photos de Jean Mohr, avec qui il collaborera à plusieurs reprises : notamment pour Art et révolution (Denoël, 1970), Le Septième Homme (Fage, réédité en 2007), Une autre façon de raconter (La Découverte, 1981) et Au bout du monde (Demoures, 2001). Ce sont les études que mènent l'écrivain sur le quotidien des paysans qui le conduiront à s'installer, dans les années 70, à Quincy, un village de Haute-Savoie. Dans les années 80, il publiera d'autres ouvrages important traitant aussi de la vie rurale : la trilogie Into Their Labours (en français "Dans leur travail", composé des romans La Cocadrille, Joue-moi quelque chose, et Flamme et lilas). Il se penche que les questions de l'exil, des migrations, des déplacements de populations, qu'il perçoit comme des phénomènes essentiels de notre époque, et sur leurs implications philosophiques.
Scénariste, dramaturge, etc.
Artiste décidément très complet, John Berger s'est également illustré en tant que scénariste, aux côtés du réalisateur suisse Alain Tanner, pour les films La Salamandre (1971), Le Milieu du monde (1974), et Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 (1976). Il est aussi l'auteur, avec Nella Bielski, de plusieurs pièces de théâtre telles que Question de Geographie qui a été jouée au théâtre national de Marseille en 1984 et au théâtre national de l'Odéon en 1986. Il collabore aussi régulièrement au Monde diplomatique.
Ses ouvrages les plus récents confirment que son engagement est resté intact : To the wedding évoque le fléau du sida, King raconte la vie des SDF à travers le regard d'un chien errant. Enfin, son dernier roman, De A à X, qui a été nominé pour en 2008 pour le Booker Prize, retrace la correspondance entre une femme vivant à Sucrate et son amant, emprisonné à vie dans la prison de Suse pour terrorisme. Il paraît en France en 2009 aux éditions de l'Olivier.
John Berger n'est donc pas un artiste pour rien. Il est "partout où ça résiste", toujours à l'affût des mutations du monde, toujours en lutte contre celle qui fondent l'injustice.
Bibliographie (extraits) :
La révolution, le terrorisme, Sarkozy... Entretien avec :
John Berger : Gauche toute
Le grand écrivain britannique John Berger a fait scandale lorsqu'il a partagé le Booker Prize pour son roman «G» avec les Black Panthers. Entretien.
«Le néolibéralisme, que j'appelle le fascisme économique, règne aujourd'hui sur la planète. Le monde est une prison. Ils nous mentent et ils nous volent. Il ne faut jamais croire ce que disent nos geôliers.» Né en 1926, John Berger n'a rien, on le voit, du vieux monsieur qui sucre les fraises.
Témoin le petit opuscule que cet Anglais marxiste et savoyard d'adoption vient de publier dans une minuscule maison d'édition de Montpellier, et où il analyse l'impasse économique actuelle, s'inspirant notamment du travail de Zygmunt Bauman. Mais Berger, qui pèse longtemps ses mots avant de s'exprimer en français avec un délicieux accent, est aussi un remarquable romancier -un des plus grands. Après le sublime «D'ici là», il publie un étrange livre épistolaire, correspondance entre Aïda et son amant, enfermé dans la cellule 73 de la prison imaginaire de Suse, pour faits de terrorisme. La critique féroce du capitalisme le dispute aux déclarations enflammées des amants. L'amour, la politique : c'est John Berger, en résumé.
Nouvel Observateur. - Le maître mot de votre oeuvre, c'est l'engagement ?
John Berger. - J'essaie simplement de me situer le plus au centre possible, je veux dire, au centre de l'expérience humaine. De nos jours, le centre de cette expérience, ce sont les marginaux. Marginaux qui, paradoxalement, sont les plus nombreux sur cette planète. Les sans-pouvoir comprennent les choses de la vie, quand ceux qui détiennent le pouvoir n'ont aucune idée de ce qu'est véritablement l'existence.
N. O. - Vous avez vous-même été tenté, à un moment ou à un autre, par la clandestinité ?
J. Berger. - Ca n'a jamais été jusque-là. Mais, dans les années 1950, j'ai fait partie du «Comité des 100», à Londres, qui a appelé à la désobéissance civile pour protester contre la course à l'armement nucléaire. Nous avons été surveillés, sans que cela tourne mal. Dans les années 1960, je suis allé souvent en URSS, et j'ai été assez proche d'artistes dissidents, dont j'ai pu sortir des oeuvres. En 1968, j'ai acheminé des messages pour les étudiants du Printemps de Prague. Ca ne fait pas de moi un terroriste !
N. O. - Mais si les circonstances en avaient décidé autrement, vous auriez pu tomber dans la lutte armée ?
J. Berger. - Je n'ai rien contre la lutte armée. Si j'avais eu le courage, j'aurais pu prendre les armes. Mais comment savoir ? Il est clair que je crois dans la lutte palestinienne, et dans le mouvement zapatiste au Mexique. La lutte d'Arundhati Roy, en Inde, je la soutiens complètement. Elle est d'un courage admirable. Elle a reçu énormément de menaces. Moi, quand j'ai eu le prix pour «G», et que je l'ai partagé avec les Black Panthers, ça a fait scandale. Ce n'était pourtant pas grand-chose.
N. O. - Quand vous étiez jeune, vous aviez une âme de rebelle ?
J. Berger. - Oui, j'étais rebelle. Mais pas contre mes parents. J'aimais beaucoup ma mère. Mon père a servi comme officier dans l'infanterie britannique, dans les tranchées de 1914, pendant quatre ans. Et il a été marqué par la guerre, dont il ne parlait d'ailleurs pas beaucoup. Je l'ai beaucoup respecté pour ce qu'il avait fait. J'ai été dans un internat de 7 à 12 ans, puis dans un autre, ce qui était pour eux un sacrifice car ça coûtait assez cher, et ils n'avaient pas grand-chose. A 16 ans, je me suis échappé d'Oxford. J'étais déjà très politisé !
N. O. - Votre père a compris vos positions politiques ?
J. Berger. - Politiquement nous étions opposés. Mais on a très peu vécu ensemble. J'ai échappé aux habituels conflits familiaux grâce au pensionnat. Le prix à payer, ça a été ma solitude, mais ce n'était pas écrasant. Au contraire, je pense que ça a créé de la disponibilité pour mon imagination en tant qu'écrivain. Je n'étais pas hanté par la figure du père, et pas étouffé par la celle de ma mère.
N. O. - Comment voyez-vous la France de Sarkozy ?
J. Berger. - C'est assez terrifiant de vivre dans cette France-là. La France avec laquelle je me suis identifié au commencement était la France de Camus, de Merleau-Ponty, de Lévi-Strauss. Je suis d'accord avec Badiou, c'est le retour de Pétain. C'est un argument absolument convaincant.
Propos recueillis par Didier Jacob- Source: "le Nouvel Observateur" du 16 juillet 2009.
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021