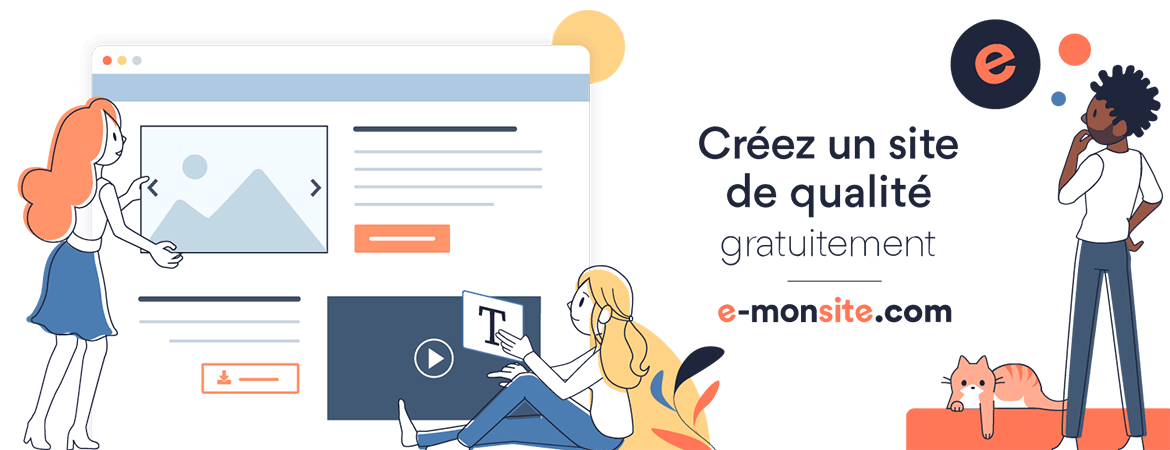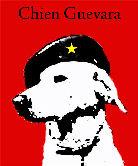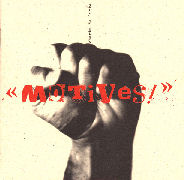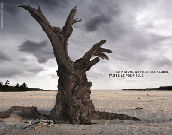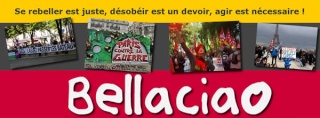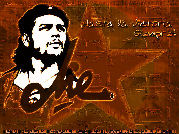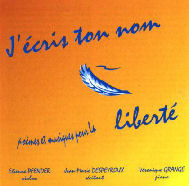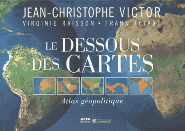Nouveau louvoiement dans le procès de l’ancien dictateur Efrain Rios Montt. Le 5 janvier, devait s’ouvrir le deuxième procès pour génocide à l’encontre du militaire, aujourd’hui âgé de 88 ans. La défense a obtenu qu’il soit reporté jusqu’à trouver un remplaçant à la présidente du tribunal, Jeannette Valdez, récusée pour avoir émis son avis sur le génocide dans un mémoire de maîtrise publié en 2004.
Les faits reprochés à l’ex-dirigeant remontent aux années 1980, au plus fort de la guerre civile qui a opposé les dictatures successives aux rebellions communistes. Le conflit qui a duré trente-six ans, de 1960 à 1996, a fait environ 200 000 victimes, essentiellement des indigènes d’origine maya (1). En 2013, Efrain Rios Montt avait été condamné à 80 ans de prison pour génocide et crime contre l'humanité, en réponse aux massacres perpétrés contre la minorité indienne maya de l’ethnie des Ixiles, faisant 1 771 victimes juridiquement reconnues, un chiffre certainement au-dessous de la réalité. Dix jours plus tard, le jugement était invalidé pour des raisons de procédure.
Terre brûlée et viols systématiques
Efrain Rios Montt accède au pouvoir en 1982. La même année, différentes unités de la rébellion se regroupent et forment l’Union nationale révolutionnaire guatémaltèque (UNRG). Le dictateur mène le pays d’une main de fer: «Si vous êtes avec nous, nous vous nourrirons, sinon nous vous tuerons.» Propos tenus par le dictateur devant des indigènes guatémaltèques, rapportés par le New York Times en juillet 1982. Dans sa lutte contre les insurgés, le pouvoir s’acharne sur les communautés mayas dans les provinces de Quiché et de Huehuetenango dans le Nord. Sans distinction entre civils et combattants, les autorités pratiquent une politique de la terre brûlée et des viols systématiques, entre autres atrocités. Les autorités considèrent les Indiens comme des «alliés naturels des guérillas» (1). A cette justification politique s’ajoute un racisme des élites à l’égard des indigènes, présent dans la société guatémaltèque depuis des décennies, analyse l’historien Daniel Hickey (2).
Lors du procès de 2013, les rescapés se sont succédé à la barre, racontant les violences dont ils ont été victimes ou témoins. «Si vous étiez mariée, alors 5 ou 10 soldats vous violaient. Si vous étiez seule, alors c’était 15 ou 20», raconte une femme, adolescente à l’époque des faits, citée par le quotidien espagnol El Pais. Les militaires et, dans une moindre mesure, les Patrouilles d’autodéfense civiles (PAC), des milices formées par Rios Montt, sont accusées de ces exactions. Selon la défense, le dictateur ignorait tout des agissements de l’armée.
Efrain Rios Montt est chassé du pouvoir en 1983 par son ministre de la Défense, Humberto Mejia Victores, qui amorcera la démocratisation du régime. Il a lui aussi été inquiété par la justice, avant l’abandon des poursuites en raison de son état de santé. Efrain Rios Montt reste donc le dernier chef d’Etat justiciable de l’époque de la guerre civile, après la mort des trois précédents despotes : Carlos Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud et Fernando Romeo Lucas Garcia.
Pour Gilles Bataillon, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), «ce procès est d’autant plus important que jusqu’à maintenant, dans les pays d’Amérique latine, les lois d’amnistie ne permettaient pas d’inculper les responsables. Les politiques avaient fait silence pour retrouver la paix sociale.» Les poursuites étaient inenvisageables dans les années qui ont suivi la guerre civile. Les généraux guatémaltèques étaient considérés comme «des vainqueurs de la lutte contre les guérillas», souligne le chercheur. Efrain Rios Montt s’était même présenté aux élections présidentielles de 2003.
A relire, notre reportage en 2003 Le come-back du caudillo guatémaltèque
L’inculpation de Rios Montt, en 2012, a été rendue possible par la Loi de réconciliation, mise en place en 1996, stipulant que l’amnistie ne pouvait pas s’appliquer aux violations des droits humains.
Mauricio Rodriguez Sanchez, ancien directeur des renseignements militaires, comparaîtra également. Il avait été acquitté lors du premier procès. «Le retard (du procès) et la dénégation de la justice signifient l’impunité», a estimé l’avocat Francisco Vivar, du Centre d’action légale pour les droits humains (Caldh), interrogé par l’AFP. «On n’a pas conscience, en France, de l’immensité des pressions exercées sur la justice au Guatemala», insiste Gilles Bataillon. Ce qui rend ce procès d'autant plus exceptionnel.
(1) Selon le rapport Guatemala, mémoire du silence (ici en anglais), rendu en 1999 par la Commission pour la clarification de l’Histoire, plus de 90% des violations des droits de l’homme pendant le conflit auraient eu lieu entre 1978 et 1984. L’enquête, financée par l’ONU, évoque plus de 626 massacres pendant toute la guerre.
(2) Daniel Hickey, « Les Mayas, victimes de l’histoire dans la guerre civile du Guatemala, 1954-1996 ».